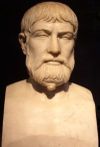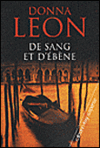Il ne faut jamais se contenter de lire une synthèse des sondages mais, si on le veut, aller dans les annexes. Dans le dernier sondage du Figaro du 3 avril 2008, 79% des français interrogés étaient pour une réduction des dépenses publiques car notre pays devait faire des efforts pour réduire ses déficits. Ils ont bien raison. Seulement quand on regarde de plus près la façon dont étaient posées les questions on s'aperçoit que cette apparente sincérité repose en fait et uniquement sur une dialectique perverse qui ne pouvait que conduire à la réponse souhaitée. Tout d'abord la synthèse ne repose que sur une seule question dans le sondage. Celui des déficits publics (page 8). Et non pas présenté avec une simple question mais à partir d'un extrait de discours du premier ministre. Il suffisait après de livrer deux assertions sur les déficits dont une indiquant ''les déficits publics de la France sont si élevés qu'il est indispensable de réduire fortement les dépenses publiques''. L'approbation sera donc massive. Mais comment aurait il pu en être autrement ?
Il ne faut jamais se contenter de lire une synthèse des sondages mais, si on le veut, aller dans les annexes. Dans le dernier sondage du Figaro du 3 avril 2008, 79% des français interrogés étaient pour une réduction des dépenses publiques car notre pays devait faire des efforts pour réduire ses déficits. Ils ont bien raison. Seulement quand on regarde de plus près la façon dont étaient posées les questions on s'aperçoit que cette apparente sincérité repose en fait et uniquement sur une dialectique perverse qui ne pouvait que conduire à la réponse souhaitée. Tout d'abord la synthèse ne repose que sur une seule question dans le sondage. Celui des déficits publics (page 8). Et non pas présenté avec une simple question mais à partir d'un extrait de discours du premier ministre. Il suffisait après de livrer deux assertions sur les déficits dont une indiquant ''les déficits publics de la France sont si élevés qu'il est indispensable de réduire fortement les dépenses publiques''. L'approbation sera donc massive. Mais comment aurait il pu en être autrement ?
Plus intéressant est l'article de l'économiste Liêm Hoang-Ngoc dans le Monde du 10 avril 2008. Je livre ici, in extenso, une partie de son analyse. Et sans commentaire une fois de plus :
Le meilleur moyen de réduire les déficits est de relancer la bonne dépense, celle qui exerce un effet réel sur la croissance. Entre 1999 et 2006,
la Grande-Bretagne
a ainsi réduit sa dette malgré un accroissement de 5 points de ses dépenses publiques, notamment destiné à créer 560 000 emplois publics, dont 150 000 dans l'éducation et 280 000 dans la santé.
Le plan de rigueur n'est justifié à l'aune d'aucun argument macroéconomique sérieux. Il n'est indispensable que dans la perspective d'un respect dogmatique du pacte de stabilité, dont Romano Prodi disait qu'il est une stupidité. L'application du pacte de stabilité est en effet à l'origine du "paradoxe de la dette" : la dette publique s'est accrue au cours de ces quinze dernières années au cours desquelles les gouvernements ont appliqué des politiques censées réduire le poids de l'interventionnisme public. Contrairement à une idée reçue, la montée inexorable des déficits n'est aucunement due à une explosion des dépenses de l'Etat et de ses dépenses de fonctionnement. La part des dépenses publiques dans le PIB est restée inchangée depuis vingt-cinq ans, autour de 53 % du revenu national.
En son sein, ce sont les dépenses sociales (santé, retraite) qui ont augmenté de plus de 2 points, sans qu'on puisse crier au scandale. La part des dépenses de l'Etat a baissé de 3 points, passant de 25 % à 22 % du PIB. Parmi celles-ci, les dépenses de fonctionnement, cibles de toutes les critiques, ont été réduites de 5 points, passant de 40 % à 35 % des dépenses de l'Etat. Les dépenses de personnel ont été réduites de 4 points, passant de 28 % à 24 % des dépenses de l'Etat. Par ailleurs, la loi organique relative à la loi de finances évalue désormais strictement chaque mission dans une perspective nécessaire de rationalisation des choix budgétaires. Enfin, les budgets des collectivités territoriales sont équilibrés, malgré de nombreux transferts de compétences réalisés sans transferts de ressources.
Le creusement de la dette publique ne provient donc pas de l'inflation de dépenses publiques, mais de la chute des recettes fiscales qui résulte de la baisse du rendement de l'impôt, induite par les réformes fiscales engagées depuis 1993, et de l'inefficacité des politiques "de l'offre". Celles-ci se sont avérées incapables d'emmener la croissance française à son taux potentiel, supérieur à 3 %.
A l'exception de la période 1998-2001, la croissance annuelle moyenne a été trop souvent en dessous des hypothèses retenues pour la construction des lois de finances. La dette publique s'est donc accrue. Elle représentait 36,5 % du PIB en 1991, avant l'entrée en application du traité de Maastricht. Elle explose entre 1993 et 1996, où elle s'élève à 58,5 % du PIB. Après un intermède lié à la reprise de 1998-2001, elle recommence à croître à partir de 2002. Elle est aujourd'hui supérieure à 64 %. Il n'y a pas d'exception française en la matière.
 Sur 6,5 milliards d'humains, 3 milliards se privent de nourriture, 2 milliards souffrent de maladies dues à des insuffisances alimentaires en fer iode ou vitamines, 854 millions ont faim presque tous les jours et 9 millions en meurent chaque année. Plus de 80% sont des paysans ou ex paysans. Le défi est de nourrir bientôt 9,5 milliards de personne dans 50 ans. Aujourd'hui il faudrait accroître de 30% la production. Avec des techniques ''durables'' ont peu accroître les rendements de 25% tout de suite.
Sur 6,5 milliards d'humains, 3 milliards se privent de nourriture, 2 milliards souffrent de maladies dues à des insuffisances alimentaires en fer iode ou vitamines, 854 millions ont faim presque tous les jours et 9 millions en meurent chaque année. Plus de 80% sont des paysans ou ex paysans. Le défi est de nourrir bientôt 9,5 milliards de personne dans 50 ans. Aujourd'hui il faudrait accroître de 30% la production. Avec des techniques ''durables'' ont peu accroître les rendements de 25% tout de suite.